Plan d'accès
Accès par l'autoroute A75 ou l'aéroport de Rodez.
|

|
Venir par la route
|

|
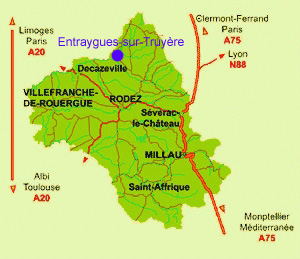
|
En provenance du Nord, de Paris :
A10, puis A71 jusqu'à Clermont-Ferrand, puis A75 direction Montpellier.
Prendre la sortie 23 direction Massiac, Aurillac.
A Aurillac, prendre la D920 direction Rodez jusqu'à Entraygues-sur-Truyère.
En provenance de la Région Lyonnaise et de l'Est :
A47 ou N88 par Saint-Etienne, puis A72 jusqu'à Clermont-Ferrand, puis A75 direction Montpellier.
Prendre la sortie 23 direction Massiac, Aurillac.
A Aurillac, prendre la D920 direction Rodez jusqu'à Entraygues-sur-Truyère.
En provenance du Nord-Ouest :
A partir de Limoges, A20 jusqu'à Tulle, puis N120 jusqu'à Aurillac, puis D920 direction Rodez jusqu'à Entraygues-sur-Truyère.
En provenance du Sud-Ouest :
A partir de Toulouse, A68 jusqu'à Albi, puis N88 jusqu'à Rodez, puis D988 jusqu'à Sébazac-Concourès, puis D904 jusqu'à Entraygues-sur-Truyère.
En provenance du Sud-Est, Marseille, Montpellier :
A9 puis N9/A75 par Lodève, Millau, direction Clermont-Ferrand.
Prendre la sortie 42 et continuer sur la N88 direction Rodez.
A Laissac, prendre la D28 jusqu'à Espalion, puis la D920 jusqu'à Entraygues-sur-Truyère.
|
|
|
| |
| |
Venir par le train
|
Plusieurs liaisons journalières :
• PARIS / RODEZ
• PARIS / AURILLAC
|
Informations & Réservations SNCF :
Site web : www.sncf.fr
|
Venir par l'avion
|
Aéroport de Rodez-Marcillac.
Site web : www.aeroport-rodez.fr |
Aéroport d'Aurillac Tronquières.
Site web : www.caba.fr/fr/aeroport/ |
| |
| |
|
| |
| |
| |
| |
|
Actualités en Aveyron
|
|
|
|
|
|
|
|
| Copyright © HOTEL-LION-OR.COM 2025 |
|