Access maps
By motorway A75 or Rodez airport.
|

|
Access by road
|

|
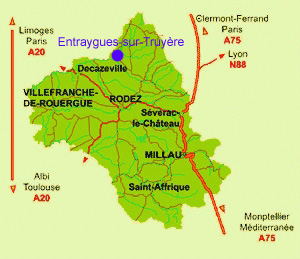
|
From the north, Paris :
A10, then A71 to Clermont-Ferrand, then A75 to Montpellier.
Take the exit 23 to Massiac, Aurillac.
In Aurillac, take D920 to Rodez until Entraygues-on-Truyère.
From Lyon and the East :
A47 or N88 via Saint-Etienne, then A72 to Clermont-Ferrand, then A75 to Montpellier.
Take the exit 23 to Massiac, Aurillac.
In Aurillac, take D920 to Rodez until Entraygues-on-Truyère.
From the North West :
From Limoges, A20 to Tulle, then N120 to Aurillac, then D920 to Rodez until Entraygues-on-Truyère.
From the South West :
From Toulouse, A68 to Albi, then N88 to Rodez, then D988 to Sébazac-Concourès, then D904 to Entraygues-sur-Truyère.
From the South East, Marseille, Montpellier :
A9 then N9/A75 via Lodève, Millau, to Clermont-Ferrand.
Take the exit 42, then N88 to Rodez.
In Laissac, D28 to Espalion, then D920 to Entraygues-sur-Truyère.
|
|
|
| |
| |
Access by train
|
Several trains each day :
• PARIS / RODEZ
• PARIS / AURILLAC
|
Information & Reservation SNCF :
Web site : www.sncf.fr
|
Access by air
|
Rodez-Marcillac Airport.
Web site : www.aeroport-rodez.fr |
Aurillac-Tronquières Airport.
Web site : www.caba.fr/fr/aeroport/ |
| |
| |
|
| |
| |
| |
| |
|
Actualités en Aveyron
|
|
|
|
|
|
|
|
| Copyright © HOTEL-LION-OR.COM 2025 |
|